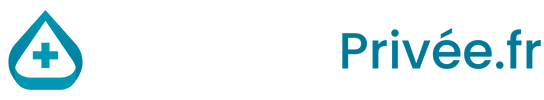Sommaire
- Qu’est-ce que l’aquamation ?
- Comment fonctionne l’aquamation ?
- Les avantages de l’aquamation
- Inconvénients et limites
- Prix de l’aquamation
- L’aquamation dans le monde
- L’aquamation en France et en Europe
- Pratiques industrielles actuelles
- Une révolution culturelle ?
- Conclusion
Face aux enjeux environnementaux croissants, de nouvelles pratiques funéraires émergent. L’aquamation, aussi appelée résomation ou hydrolyse alcaline, est présentée comme une alternative plus respectueuse de l’environnement que la crémation traditionnelle. Encore méconnue du grand public, elle suscite un intérêt croissant en Europe, notamment en France.
1. Aquamation : définition ?
La définition de l’aquamation est un procédé de disposition corporelle post-mortem qui utilise l’eau, la chaleur et un produit alcalin (généralement l’hydroxyde de potassium ou de sodium) pour décomposer le corps humain. Contrairement à la crémation par le feu, la crémation à l’eau, elle, repose sur un processus chimique d’hydrolyse alcaline.
Ce traitement mélange 95 % d’eau et 5 % de solution alcaline, chauffé à environ 150 °C sous pression pendant plusieurs heures. Cette réaction transforme les tissus en un liquide stérile et incolore, laissant uniquement les os, qui sont ensuite broyés pour obtenir une poudre semblable à celle résultant d’une crémation.
2. Comment fonctionne l’aquamation ?
L’aquamation, aussi appelée hydrolyse alcaline ou crémation à l’eau, repose sur un procédé chimique doux et écologique permettant de décomposer le corps humain sans flamme. Voici les étapes clés de ce processus funéraire innovant :
🔧 Étape 1 : Préparation du corps
Le défunt est déshabillé et placé dans un conteneur en acier inoxydable ou une unité pressurisée étanche, spécialement conçue pour résister aux températures et aux substances alcalines. Aucun cercueil n’est utilisé, mais un linceul biodégradable peut être fourni selon les choix du défunt ou de la famille.
💧 Étape 2 : Lancement de l’hydrolyse alcaline
Une solution composée de 95 % d’eau et de 5 % d’hydroxyde de potassium (ou de sodium) est introduite dans la cuve.
Le liquide est ensuite chauffé entre 95°C et 160°C sous pression contrôlée, afin d’empêcher l’ébullition. Ce processus, qui dure 3 à 6 heures, provoque une désintégration accélérée des tissus organiques par un phénomène chimique naturel : la saponification et la lyse cellulaire.
🚿 Étape 3 : Rinçage, séchage et transformation des restes
À la fin du cycle :
- Les éléments solides restants (principalement les os) sont rincés, séchés, puis réduits en poudre blanche très fine à l’aide d’un broyeur spécialisé, comme pour la crémation.
- Ces « cendres aqueuses » sont ensuite placées dans une urne.
🕊️ Étape 4 : Restitution des cendres
La famille reçoit les cendres du défunt, qu’elle peut conserver, disperser ou inhumer, selon les volontés exprimées.
🌱 Étape 5 : Traitement du liquide résiduel
La solution aqueuse restante, totalement stérile et exempte d’agents pathogènes, est évacuée selon les réglementations locales :
- Évacuation dans les eaux usées (comme pour un effluent biodégradable)
- Ou réutilisation agricole en tant que fertilisant liquide riche en nutriments, dans certains pays autorisant cette pratique.
Ce processus respecte les normes sanitaires tout en réduisant l’empreinte écologique. Il ne génère ni CO₂, ni vapeurs toxiques, ni particules fines.
3. Les avantages de l’aquamation
a. Une option plus écologique
- Moins d’émissions de gaz à effet de serre
- Pas de métaux lourds ni vapeurs toxiques rejetés dans l’air
- Consommation d’énergie réduite (jusqu’à 90 % de moins qu’une crémation)
b. Respect du corps
Le procédé est perçu comme plus doux et naturel par certains proches.
c. Plus de cendres pour la famille
Le volume de « cendres » obtenu est souvent plus important qu’à l’issue d’une crémation traditionnelle.
d. Acceptation croissante par les professionnels
De plus en plus de maisons funéraires et de structures hospitalières s’y intéressent comme solution durable.
4. Inconvénients et limites
- Procédé encore mal connu du grand public
- Réglementations floues voire absentes dans de nombreux pays
- Nécessite un équipement coûteux et spécialisé
- Débats sur le rejet du liquide, même stérile, dans les égouts
5. Prix de l’aquamation
Le coût de l’aquamation, également appelée hydrolyse alcaline, varie en fonction de plusieurs facteurs : le pays, la législation en vigueur, le prestataire de services funéraires, ainsi que les options choisies (cercueil biodégradable, urne, cérémonie, transport, etc.).
💸 Tarifs moyens de l’aquamation par région :
Les prix de l’aquamation sont comparables voire légèrement inférieurs à ceux de la crémation traditionnelle, surtout si l’on considère les coûts environnementaux à long terme. Elle nécessite moins d’énergie et ne génère pas d’émissions de dioxyde de carbone, ce qui la rend aussi plus écologique.
| Région | Prix moyen de l’aquamation |
|---|---|
| Amérique du Nord | Entre 1 500 et 3 500 USD, selon l’État et les services inclus |
| Australie | De 2 000 à 4 000 AUD, avec des variations selon les régions |
| Europe (dans les pays où elle est autorisée) | De 1 800 à 3 000 €, souvent en phase de déploiement ou en expérimentation |
📌 Facteurs influençant le coût de l’aquamation :
- Réglementation locale (légalité et autorisation du procédé)
- Niveau de service (cérémonie, récupération des cendres, transport)
- Type de matériel utilisé (conteneurs biodégradables, urne, etc.)
- Disponibilité de la technologie (procédé encore peu répandu en Europe)
6. L’aquamation dans le monde
a. Amérique du Nord
- L’aquamation est autorisée dans plus de 20 États américains.
- Des entreprises comme Resomation Ltd ou Bio-Response Solutions fabriquent les équipements.
- Utilisée pour les humains et les animaux domestiques.
b. Canada
- Pratique autorisée au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.
- Certaines compagnies funéraires la proposent comme alternative à la crémation.
c. Australie et Nouvelle-Zélande
- La Nouvelle-Galles du Sud autorise l’aquamation.
- Forte croissance dans les secteurs vétérinaires et funéraires.
7. L’aquamation en France et en Europe
a. Situation en France
En 2024, l’aquamation n’est pas encore autorisée en France pour les défunts humains. Elle est cependant pratiquée pour les animaux domestiques.
Un débat public est en cours, porté par des élus, des écologistes et des entrepreneurs du funéraire. Le droit français ne reconnaît aujourd’hui que deux modes de traitement des corps : l’inhumation et la crémation. L’aquamation serait une troisième voie.
b. En Belgique, Suisse, Allemagne
- Belgique : l’aquamation est en phase de test, notamment à l’initiative de certaines sociétés funéraires flamandes.
- Suisse : discussions en cours dans les cantons, intérêt des communes mais frein juridique.
- Allemagne : encore interdite mais la question est soulevée dans certains Länder.
8. Pratiques industrielles actuelles
Si l’aquamation est encore marginale pour les humains en Europe, elle est déjà utilisée dans :
- Le secteur vétérinaire : nombreuses cliniques proposent l’aquamation des animaux domestiques.
- La recherche scientifique : les laboratoires utilisent ce procédé pour la dissolution de tissus biologiques.
- Les armées : certains pays ont testé l’aquamation pour le traitement des corps de militaires (procédé plus respectueux et hygiénique).
9. Une révolution culturelle ?
Changer de rapport à la mort est aussi une affaire de mœurs. L’aquamation invite à repenser la façon dont nous honorons les défunts et traitons les corps :
- Acceptation croissante de la crémation dans des sociétés autrefois très attachées à l’inhumation
- Prise de conscience environnementale, même dans le domaine funéraire
- Désirs de « mort douce » ou de fin de vie écologique chez certaines personnes
Des collectifs citoyens et des entreprises funéraires militent pour inscrire l’aquamation comme une option légitime, au même titre que la crémation.
10. Perspectives d’avenir et innovations attendues
L’aquamation est encore au stade d’innovation en France, mais le marché mondial montre un potentiel considérable. De nouveaux modèles de machines, plus compacts et moins énergivores, sont en développement. Les législations évoluent également, avec des discussions engagées dans plusieurs pays européens pour adapter les textes réglementaires aux nouvelles pratiques funéraires.
Les grands groupes funéraires, conscients des enjeux écologiques et des attentes sociétales, investissent dans la recherche et les partenariats avec les fabricants d’équipements. Certaines start-ups émergent également dans le domaine des funérailles durables, proposant des services personnalisés autour de l’aquamation, avec accompagnement spirituel et valorisation symbolique des « cendres liquides ».
Enfin, l’éducation du public joue un rôle central. Des campagnes de sensibilisation pourraient contribuer à démystifier la pratique et à la rendre plus acceptable culturellement. Les écoles de thanatopraxie et les instituts de formation au funéraire commencent à introduire l’aquamation dans leurs programmes.
Conclusion
L’aquamation est bien plus qu’une nouveauté technologique : c’est une réponse moderne à des enjeux écologiques, éthiques et sociaux. Bien qu’encore peu répandue en France, elle suscite un intérêt croissant et pourrait, à terme, redéfinir les pratiques funéraires. Face à une demande citoyenne de plus en plus forte pour des obsèques durables, l’aquamation a toutes les chances de devenir une norme dans les années à venir.
FAQ sur l’Aquamation
Où va l’eau utilisée lors de l’aquamation ?
L’eau utilisée pendant l’aquamation est filtrée, stérilisée, puis rejetée dans les eaux usées conformément aux normes environnementales. Elle ne contient plus de matière organique et ne présente aucun risque sanitaire ou écologique.
Est-il possible de disperser les cendres issues de l’aquamation ?
Oui, comme pour la crémation, les cendres peuvent être conservées dans une urne, dispersées en pleine nature, ou déposées dans un site cinéraire, sous réserve du respect de la réglementation française.
L’aquamation est-elle plus écologique que la crémation ?
Oui. L’aquamation réduit de près de 90 % les émissions de CO₂, consomme moins d’énergie et ne rejette pas de mercure dans l’atmosphère, contrairement à la crémation traditionnelle.
Peut-on faire une aquamation pour les animaux ?
Oui, l’aquamation est déjà utilisée pour les animaux de compagnie dans plusieurs pays. C’est une alternative douce, respectueuse de l’environnement et de plus en plus populaire dans le secteur vétérinaire.
Quel est le coût d’une aquamation par rapport à une crémation ?
L’aquamation coûte en moyenne entre 1 800 et 3 000 euros, soit un tarif similaire à celui d’une crémation. Le prix dépend des options choisies : urne, cérémonie, transport, etc.
Quelle est la durée d’une aquamation ?
Le processus d’aquamation dure entre 3 et 4 heures. Ce délai varie selon la température, la pression utilisée, et la méthode employée (standard ou accélérée).
Qui peut demander une aquamation en France ?
En principe, les proches du défunt peuvent en faire la demande. Toutefois, l’aquamation n’étant pas encore autorisée en France, elle reste inaccessible pour le moment, sauf à l’étranger.